En 2003, le discours américain annonçant « l’instauration d’un État démocratique garantissant les libertés civiles, la liberté d’expression, une réconciliation nationale, une justice équitable et apolitique » est évidemment resté lettre morte. Dès janvier 2008, Hans Von Sponeck, ancien coordinateur du programme Pétrole contre nourriture en Irak de 1998 à 2000, constatait sur le site suisse Horizon et Débats que, dans ce pays, rien ne se déroulait normalement : « Les élections n’étaient pas des élections normales, la reconstruction n’est pas normale, l’invasion a été à l’encontre du droit international, tout comme l’occupation. Dans aucun domaine on ne rencontre des conditions normales. Cela vaut pour le Parlement, pour le gouvernement et pour la justice. » Dix ans après le renversement du président Saddam Hussein, le chaos s’est installé.
Justice aux ordres
L’instauration d’une démocratie à l’occidentale en Irak était une vue de l’esprit. Les élections législatives de 2005 et 2010 ayant tourné à la mascarade, les dirigeants qui en sont issus ne sont considérés comme légitimes que par leurs partisans. La débaasification du pays a été menée par un Conseil de débaasification au fonctionnement opaque, dirigé par Ahmed Chalabi et Nouri al-Maliki. Pas moins de 150 000 professeurs, fonctionnaires, policiers, furent licenciés pour délit d’opinion rien qu’entre mai et septembre 2003.
Alors que les péripéties du procès du président Saddam Hussein déconsidéraient la justice dite transitionnelle, Nouri al-Maliki assurait qu’il était « exemplaire ». Il lui importait peu que trois avocats de la défense aient été assassinés, qu’un juge eût dû démissionner et un autre remplacé sans explication. Qu’importe si, pour une majorité d’Irakiens – y compris d’anciens opposants –, la condamnation à mort de Saddam et son lynchage télévisé, le 30 décembre 2006, jour où les sunnites fêtaient l’Aïd al-Adha, ont été perçus pour ce qu’ils étaient : une ignoble revanche sectaire (1). Difficile ensuite de parler de réconciliation nationale… Et pourtant c’est ce à quoi Nouri al-Maliki, élu premier ministre, s’employait parallèlement, à la demande de Zalmay Khalilzad, ambassadeur des États unis à Bagdad. En fait de dialogue, ses partenaires se réduisaient aux membres de partis et aux personnalités plus ou moins indépendantes tolérés par les Américains et les Iraniens. Les nationalistes dans la clandestinité et les prisonniers politiques internés par les troupes d’occupation, avec lesquels il aurait dû prendre langue, en étaient exclus. Question hypocrisie ou double langage, on ne fait pas mieux. Onze organisations de la résistance condamnèrent l’opération comme étant un leurre.
Des femmes emprisonnées secrètement
Les manifestations antigouvernementales qui se déroulent depuis le 23 décembre dernier à Ramadi, Samarra, Bagdad, Mossoul et Tikrit – soutenues par des chefs de tribu du sud de l’Irak et des organisations de résistance – ont justement pour origine la persécution et la discrimination dont les sunnites sont victimes. Au Parlement, les députés sunnites qui réclament la libération de prisonniers politiques – notamment des femmes – ainsi que l’abrogation des lois antiterroristes en sont venus aux mains avec leurs collègues chiites… Selon le ministère irakien de la Justice, le nombre des détenues serait de 980. Salim al-Jibouri, député de l’opposition (Iraqiya), parle de 1 500, la plupart sur de simples soupçons.
Les variations constatées dans les statistiques carcérales s’expliquent par le fait que les organismes concernés – premier ministre, Intérieur, Justice – disposent de leurs propres prisons. Inutile de dire que les personnes incarcérées dans des geôles secrètes ne sont pas comptabilisées. À Ramadi, où la révolte enfle, quatre-vingts femmes auraient été découvertes dans l’une d’elles, gardées par des miliciens chiites. Dans son rapport de janvier 2012, l’ONG Human Rights Watch qualifie l’Irak d’« État policier en devenir ». Pour de nombreux Irakiens, il l’est déjà, et depuis longtemps ! La condamnation à mort par cinq fois, pour « terrorisme », de Tareq al-Hachemi, vice-président sunnite de la République, et la tentative d’arrêter Rafaï al-Essawi, son ministre sunnite des Finances – originaire de la province d’Al-Anbar – pour le même chef d’inculpation, en sont les exemples les plus flagrants.
Aujourd’hui, l’insécurité et les injustices sont telles que les représentants de la minorité arabe sunnite, opposés en 2005 à l’introduction du fédéralisme dans la nouvelle Constitution, menacent de déclarer l’autonomie des provinces où leur communauté est majoritaire. Ils n’ont plus le choix, disent-ils. C’est peut-être ce à quoi l’Iran, après Israël et les néoconservateurs américains, veut en venir.
Les excuses présentées, le 14 janvier dernier, par le vice-premier ministre Hussein al-Shahristani – sous la pression de la rue – à quelque 300 prisonniers dont la détention était injustifiée, calmeront un temps l’ardeur de certains manifestants, mais pas le vent de révolte qui souffle dans nombre de provinces irakiennes.
(1) Voir « Saddam face à l’Histoire – Crimes et mensonges de l’Occident », in Afrique Asie, janvier 2010.


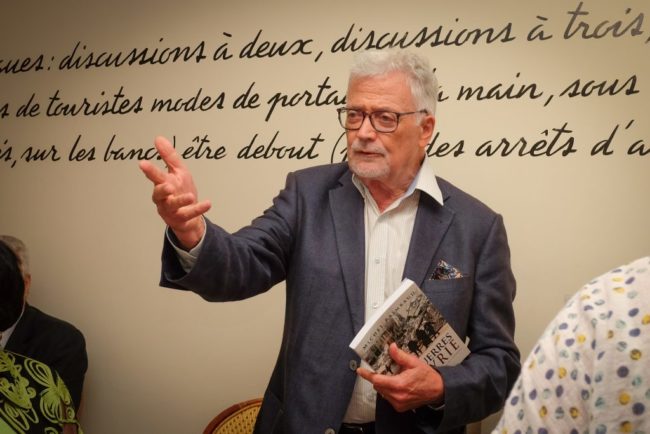



 Merci de patienter...
Merci de patienter...



