Co-auteur, avec Nassim Oulmane et Mustapha Sadni Jallab, de Crise… Naufrage des économistes ? et collaborateur régulier à Afrique Asie,
Hakim Ben Hammouda pointe du doigt plusieurs facteurs pour expliquer l’échec retentissant des économistes dans la crise financière internationale qui a secoué et secoue encore la planète. Le premier d’entre eux est sans nul doute le dogme du marché libre et sa prétendue capacité d’autorégulation, défendu par des courants puissants, voire hégémoniques, de la pensée économique qui ont triomphé depuis la décennie quatre-vingt. La crise a sonné le réveil. L’État, honni jusqu'à il y a peu, est appelé à la rescousse. Mais peut-il remettre de l’ordre dans une économie mondiale hautement financiarisée et délibérément opaque ? Et quelles leçons a-t-on vraiment tirées de la crise dans les pays du Nord comme dans les économies émergentes et en développement ?
Parmi les raisons évoquées pour expliquer l’incapacité des économistes à prévoir la crise, vous citez celle de l’Américain Francis Fukuyama : de nombreux économistes « travaillent pour des banques, hedge funds, etc., pour lesquels ils élaborent des modèles complexes qui, rétrospectivement, se sont révélés inaptes à prévoir la crise. Leur intérêt personnel dans le succès du secteur financier n’est compensé par aucune incitation à penser que dans son ensemble le secteur détruisait davantage de valeur qu’il n’en créait ». Vous rejetez cette hypothèse. Mais n’y a-t-il pas un problème de cette nature, puisque les économistes influents sont, du moins en apparence, « embedded » (« embarqués », « imbriqués ») avec le capital financier et font partie du système économique qu’ils ne peuvent que défendre et en souhaiter la pérennité ?
Notre livre cherche à comprendre les raisons qui ont empêché les économistes de prévoir la crise. Nous avons examiné une série de réponses qui étaient en débat depuis la fameuse question candidement adressée par la reine d’Angleterre au directeur de la prestigieuse London School of Economics, sur les raisons de la faillite collective des économistes. L’une d’entre elles est celle avancée par l’essayiste américain Francis Fukuyama. Il souligne que cette faillite est liée à une grande alliance des économistes avec les milieux d’affaires, les premiers siégeant notamment dans les conseils d’administration des banques ou des fonds d’investissement. Cela les a empêchés de prendre des mesures contre l’aventurisme croissant et les prises de risque inconsidérées du monde des affaires. Il s’agirait plus d’une attitude délibérée, d’un complot de la part des économistes que d’une faillite. Cette hypothèse du complot a suscité un grand nombre de réactions outre-Atlantique mais également en France. Certains analystes ont soutenu cette interprétation en fournissant une série d’arguments montrant la collusion des milieux des économistes et des milieux financiers.
Dans notre essai, nous avons rejeté cette hypothèse pour deux raisons. D’abord, nous pensons que la thèse du complot peut expliquer la faillite de certains économistes mais certainement pas d’une majorité d’entre eux, dont beaucoup n’ont pas de rapport avec les cercles financiers. Par ailleurs, nous avons privilégié une explication plutôt endogène à la discipline qui situe cette faillite collective dans les mutations du champ économique.
Parmi les facteurs de la dérive collective des économistes, vous soulignez les « mutations de cette discipline, de son objet, de ses méthodes et de son rapport au politique ». Son ultra-spécialisation, qui l’a éloignée des sciences sociales pour la pousser vers les mathématiques dures, est une des causes de la « dépolitisation » de la profession…
Les mutations du champ économique, dans lesquelles s’inscrit cette faillite collective, ont commencé bien avant celles que le champ politique va connaître dans les années 1980 avec l’avènement du néolibéralisme. Elles s’observent dès le milieu des années 1970 avec la renaissance du courant néoclassique ou néolibéral. Auparavant, le champ de la réflexion mais aussi de l’action économique, avait été dominé depuis la grande crise de 1929 par la pensée keynésienne qui accorde une grande place à l’État dans le fonctionnement des économies. Or, les limites de l’État-providence dans les années 1970 et la multiplication des crises ont remis en cause les préceptes keynésiens et permis un retour en force du néolibéralisme.
Contre-révolution libérale
Avec la crise du keynésianisme, on va assister à une profonde modification du champ intellectuel. L’école néolibérale justifie les politiques économiques menées dans les années 1980, notamment la marginalisation du rôle de l’État et l’avènement en force du marché. À cette époque, Robert Lucas, nobélisé peu après, n’a pas hésité à annoncer de manière triomphale la mort de Keynes. Plus tard, on assistera à un retour de ce qu’on appelle le néokeynésianisme et à la mise en place, dans les années 1990, d’une synthèse qui cherche à concilier la prééminence du marché et certaines contraintes, en particulier dans le domaine de l’information ou de la concurrence.
On n’a pas assez étudié, de mon point de vue, cette mutation. Nous faisons l’hypothèse qu’elle est à l’origine des difficultés des économistes dans la mesure où elle a été à la base de la construction des croyances qui ont conduit les économistes à la faillite. Le consensus s’est fondé sur le principe de la solidité du système et de sa capacité à répondre à toutes les crises, principe qui se justifie par l’efficacité des marchés et la totale rationalité des agents. Rien ou presque ne peut perturber le fonctionnement du système économique. Or, la crise actuelle est venue remettre en cause ces croyances ; elle a montré la fragilité du système et la capacité des agents, notamment des traders aventuriers, à le mettre en péril.
La question de fond n’est-elle pas la réduction progressive de la marge de manœuvre du politique face aux dogmes libéraux souscrits par la plupart des pays occidentaux et des communautés politiques et économiques telles que l’Union européenne??
Les années 1980 et 1990 ont été tellement marquées par l’hégémonie de la pensée libérale que certains, comme Fukuyama, ont annoncé la fin de l’Histoire. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la construction de cette hégémonie dans le champ économique. Nous avons essayé d’en comprendre les raisons. Nous avons souligné une série de facteurs qui expliquent l’avènement en force de ce paradigme. La première est bien sûr la survivance de la pensée néolibérale et le fait qu’elle a continué à vivre en dépit d’une hégémonie sans précédent de la pensée keynésienne et de l’interventionnisme étatique dans la période de l’après-guerre. Milton Friedman a toujours poursuivi son combat pour le libre marché. Il faut aussi noter la multiplication des crises et l’incapacité des recettes keynésiennes habituelles à leur apporter une réponse. On a assisté, dès le début des années 1970, à une montée du chômage et de l’inflation. Ces années de stagflation ont mis à mal l’héritage keynésien et de l’intervention publique qui avaient permis au monde développé de connaître une fabuleuse période de croissance appelée les Trente Glorieuses. Leurs échecs seront à l’origine de la contre-révolution classique ou libérale dans le champ économique. Elle va préparer le changement politique des années 1980 avec la crise de la social-démocratie et l’avènement des pouvoirs néolibéraux.
Quel rôle peuvent jouer les économistes dans un tel contexte ? Peuvent-ils revendiquer l’indépendance de la profession par rapport aux décideurs politiques ? Et ne serait-ce pas à ces derniers de prévoir les risques que des systèmes économiques peuvent engendrer ?
Les rapports entre économistes et hommes politiques ne sont pas simples. La contre-révolution de la pensée néolibérale dans le champ économique a, en quelque en sorte, préparé la révolution politique libérale. Aujourd’hui, la situation est totalement différente. Une majorité d’économistes recommande de poursuivre les politiques non conventionnelles mises en place après la crise, avec un relâchement des politiques monétaires et la mise en place de politiques de relance fiscale afin d’éviter la déflation. En même temps, les responsables politiques appellent à la fin de ces politiques pour deux raisons. La première est qu’on assiste à une reprise de l’économie, donc il n’y a pas de raison de maintenir les mesures hétérodoxes. La deuxième se niche dans le creusement des déficits budgétaires dans beaucoup de pays, notamment en Europe. D’où les appels à une consolidation budgétaire et la fin des politiques non conventionnelles.
Quelles leçons tirer des réponses que les grandes puissances ont apportées à la crise ? Business as usual, ou début de changements plus ou moins substantiels ? Qu’en est-il du mouvement d’idées dont vous faites état au sein des économistes issus du système dominant ?
La crise a été à l’origine de profonds changements dans la réflexion mais aussi dans l’action et les politiques économiques. Un consensus a été établi sur quatre questions majeures. D’abord, on a souligné la responsabilité de la finance et la nécessité de mettre en place des régulations fortes capables de faire face à l’aventurisme des traders. Ensuite, on a rompu avec l’orthodoxie monétaire et tous les pays ont réduit fortement leurs taux d’intérêt qui sont, dans certains pays, proches de zéro. Les politiques de relance budgétaire, qui étaient quasiment interdites par les courants dominants, sont à l’ordre du jour. Il faut noter que la reprise de la croissance est beaucoup plus marquée dans les pays qui ont appliqué les programmes les plus ambitieux. Enfin, on a mis en place une nouvelle gouvernance globale avec le G20 qui a donné une place importante aux pays émergents dans la gestion de l’ordre mondial.
économistes hétérodoxes
Certes, on constate un retour aux principes non conventionnels de politique économique, avec des réformes financières et des appels à une plus grande régulation qui ont connu quelques pas décisifs dans certains pays. Mais on n’a toujours pas abouti à une vision cohérente au niveau global. De plus, la crise de la dette souveraine de certains pays en Europe du Sud, dont la Grèce, l’Espagne et le Portugal, a favorisé le retour des thèses de la consolidation budgétaire et de la rigueur qui peuvent remettre en cause une reprise encore très fragile.
Quels modèles économiques – ou « variantes » à l’intérieur d’un même modèle – s’affrontent-ils ? Quel est l’apport des penseurs proches de l’altermondialisme ou des réformistes du système capitaliste dans la réflexion sur la reconstruction du champ économique et dans la refondation, même timide, de l’ordre mondial ?
Dans le champ de la réflexion économique, la crise a permis une plus grande ouverture sur la diversité des courants et des analyses. Le débat n’est plus limité à la synthèse entre néolibéraux et néokeynésiens. Des keynésiens radicaux, comme Paul Krugman, sont de plus en plus écoutés. La preuve, il a obtenu le prix Nobel en 2008. D’autres économistes hétérodoxes sont également plus influents. Toutefois, on a l’impression que la marge de liberté acquise après la crise se rétrécit, même si une grande partie des économistes continue à appeler au maintien des mesures de politiques économiques non orthodoxes. Si on assiste au développement rapide des travaux mettant l’accent sur l’incertitude et le risque, on n’en observe pas moins, parallèlement, un retour des politiques antérieures à la crise. Dans nombre de pays, l’inflation est au centre des préoccupations alors que l’économie mondiale est plus proche de la dépression, voire de la déflation pour certains pays, que d’un processus inflationniste.
Assiste-t-on tout de même à un retour de l’État, à un renforcement de ses prérogatives de régulation, dans la gestion de l’économie ?
Nul doute que la crise de l’automne 2008 a été à l’origine d’une forte remise en cause du dogme du marché. L’État, la régulation de l’ordre financier, un plus grand contrôle des activités financières deviennent des questions au centre du débat économique. Ce sont les plans de sauvetage mis en place dans les grands pays développés qui ont aidé les banques et empêché une faille du système au lendemain de la chute de la banque Lehman Brothers. Dès le début 2009 et jusqu’à aujourd’hui, ce sont les politiques de relance fiscale et les stimuli mis en place dans certains pays qui ont empêché une forte dépression économique ou la déflation. Les États-Unis ont voté en juillet une loi qui réduit franchement la marge de liberté des banques et des acteurs financiers. Cette question sera au centre du prochain sommet du G20, en novembre 2010, à Séoul. Les experts sont en train de plancher sur de nouvelles normes beaucoup plus restrictives qui vont réduire la marge de liberté des banques. C’est ce qu’on appelle les « accords de Bâle 3 ».
Que dire de l’inéluctabilité de la crise qui serait, selon les économistes marxistes, à caractère systémique et intrinsèque au modèle de financiarisation extrême de l’économie, dominant à l’heure actuelle ?
Il y a aujourd’hui un large consensus sur le caractère systémique de la crise. Effectivement, la libéralisation financière ayant remis en cause la loi Glass-Steagall, adoptée aux États-Unis après la crise de 1929 et qui avait mis d’importantes restrictions au fonctionnement des marchés financiers, a engendré une financiarisation sans précédent des économies et une véritable déconnexion de la sphère réelle. La libéralisation a aussi vu l’émergence de nouveaux produits et d’importantes innovations financières qui ont contribué à la forte progression de la financiarisation des économies. Sans compter l’effet de levier qui a facilité l’accès aux financements ayant nourri la fuite en avant des marchés financiers et eu sur l’économie un formidable effet, renforçant la vigueur des cycles économiques, tant en phase d’expansion qu’en phase de récession. L’ensemble de ces évolutions financières a conduit à la crise sans précédent que nous connaissons.
Lobbying contre les réformes
Aujourd’hui, le débat porte sur les moyens de faire face à cette financiarisation et aux moyens d’empêcher une nouvelle crise systémique. La régulation bancaire et financière est au centre des préoccupations des chercheurs économistes mais aussi politiques. Le débat en cours et les propositions de réformes rencontrent d’importantes résistances de la part des grandes banques et des milieux financiers. Ils dépensent sans compter et font un lobbying sans limites afin d’éviter les réformes ou de les vider de leur contenu, ce qui leur permettra de poursuivre la finance facile. Leur argument : les nouvelles règles, comme la hausse des réserves obligatoires, risquent d’augmenter le coût du crédit et pourraient par conséquent ralentir les investissements, la croissance et l’emploi.
Néanmoins, en dépit de l’opposition des milieux financiers, je suis persuadé que les réformes vont se poursuivre et réduire les risques systémiques.
Les puissances émergentes peuvent-elles présenter une alternative au modèle dominant – dont elles profitent par ailleurs ? Le groupe de Shanghai ou certains regroupements économico-politiques d’Amérique latine constituent-ils des formes de « résistance idéologique » contre les dérives du système mondial ou de simples réactions conjoncturelles d’autodéfense ?
Le phénomène de l’émergence est bien antérieur à la crise et constitue un important développement dans l’économie mondiale. Dès le début des années 1980, alors qu’un grand nombre de pays en développement étaient embourbés dans la crise de la dette, on a commencé à parler des dragons asiatiques – Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour – qui ont connu des performances économiques exceptionnelles avec des taux de croissance à deux chiffres. Leur croissance s’est accompagnée d’une forte diversification des structures économiques. Ces pays ne sont plus de simples exportateurs de matières premières mais sont devenus d’importants acteurs de l’économie mondiale. Dans les années 1990, on a parlé des tigres asiatiques : Malaisie, Indonésie, Thaïlande et Philippines. Plus récemment ce sont les Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine) qui ont émergé. On le sait moins, mais ce phénomène s’est étendu à l’Afrique, même si son ampleur est beaucoup moins marquée et que la crise a remis en cause les performances de certains pays africains.
Le phénomène de l’émergence, limité au début des années 1980, est devenu une tendance forte avant la crise. Pour la première fois dans l’histoire, la frontière du développement ne s’est plus arrêtée au Nord et s’est déplacée vers les pays du Sud. Ce phénomène a été renforcé lors de la crise et les pays émergents ont consolidé leur rôle et leur place dans l’économie mondiale. Au point que certaines internationales parlent carrément de basculement du monde. L’ouverture des instances de la gouvernance globale, comme l’établissement du G20, est assez significative de ces changements profonds.
Les pays du Sud se trouveraient paradoxalement dans une meilleure situation pour tenter de remplacer le libéralisme triomphant. Mais peuvent-ils y réussir sans la mise en place d’une nouvelle macro-économie internationale pour laquelle il n’y a pas, à l’heure actuelle, un rapport de force favorable ?
Effectivement, la crise actuelle s’est accompagnée d’un important débat sur le modèle exportateur mis en place par les pays émergents qui leur a permis d’améliorer leur compétitivité et, surtout, d’accumuler de forts excédents commerciaux. Ces excédents ont été critiqués et certains considèrent qu’ils ont alimenté l’endettement excessif de certains pays et la financiarisation. D’où les appels répétés à recentrer la croissance sur les marchés internes dans beaucoup de pays émergents. Cela est d’autant plus important que les pays développés, face à la crise et la fragilité de la croissance, ne peuvent plus jouer leur rôle de locomotive de l’économie mondiale comme par le passé. Mais si on examine les plans de relance économique mis en place par nombre de pays émergents, on remarque qu’ils consacrent une large dimension au marché intérieur à travers les plans d’infrastructure, le renforcement des systèmes de Sécurité sociale. D’autre part, certains pays ont consolidé leur intégration régionale et les marchés régionaux jouent un rôle dynamique dans la croissance. Malgré ces évolutions, le marché international reste important et majeur son rôle dans la croissance économique des pays émergents.
Pour les pays en voie de développement, quelles sont les conditions indispensables à une réappropriation du modèle économique au niveau national ou régional et à la mise en place d’un nouveau modèle de développement économique ?
Tous les pays en développement ne disposent pas de marchés assez larges, comme c’est le cas pour les pays émergents. Donc, le commerce international et l’accès à d’autres marchés sont des piliers importants pour ses pays. À ce propos, la finalisation du cycle de Doha est importante pour les pays en développement dans la mesure où elle leur permet d’avoir de plus grandes possibilités d’accès au marché. L’économie mondiale se trouve à un tournant majeur de son histoire. L’enjeu est de renforcer une coopération internationale ouverte sur le monde en développement afin de sortir de la crise et de construire un nouveau modèle global de co-développement durable et plus équitable.





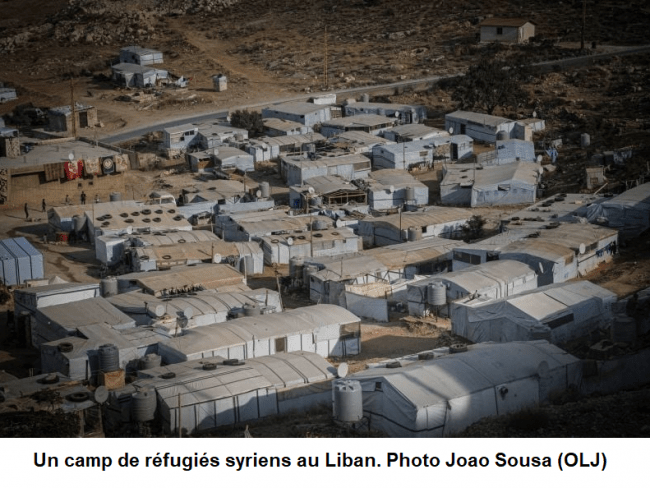
 Merci de patienter...
Merci de patienter...



