Les contentieux juridiques entre le gouvernement et les compagnies étrangères, ainsi que la mauvaise humeur de la Banque mondiale, pourraient compromettre l’essor annoncé du secteur.
À en croire le ministère des Mines, la production de cuivre et de cobalt, qui représente plus de la moitié de la valeur des exportations, pourrait atteindre respectivement 450 000 tonnes et 60 000 tonnes à la fin de l’année. De quoi renouer avec les records atteints durant les années 1980. Et d’ici à 2015, la République démocratique du Congo (RDC) devrait se hisser au 2e?rang mondial des producteurs de cuivre derrière le Chili, avec une production de 1,94 million de tonnes.
D’importants projets doivent encore entrer en production dans les trois années à venir, comme celui du canadien Ivanhoe, sur le site de Kamoa, à l’ouest de Kolwezi, avec un potentiel de 100 000 tonnes de cuivre par an. Dès octobre, devrait démarrer le projet le plus important de tous : l’exploitation des gisements attribués à la joint-venture Sicomines, dont le capital est détenu à 68 % par les sociétés chinoises Sinohydro, China Railways et China Metallurgical Group Corporation, et à 32 % par les entreprises d’État congolaises Gécamines et Congo Simco. L’enjeu porte sur l’accès à des réserves de 10,6 millions de tonnes de cuivre et 609 000 tonnes de cobalt. En échange de quoi les promoteurs s’engagent à construire pour 6 milliards de dollars d’infrastructures.
Explosion sociale
Mais ces prévisions euphoriques pourraient être contrariées sur le terrain. En août dernier, le secrétaire exécutif du Bureau de coordination du programme sino-congolais, Moïse Ekanga, a dû se rendre au Katanga pour tenter de persuader les creuseurs artisanaux de libérer le site avant le début de l’exploitation. Quantité d’autres concessions sont également occupées par les creuseurs, dont le nombre est estimé à plusieurs centaines de milliers dans le seul Katanga par l’économiste belge Jan Gorus. Celui-ci disait redouter une explosion sociale à la fin 2008. Elle est en train de se produire. Des affrontements violents ont eu lieu le 21 juin entre la police et des creuseurs artisanaux, près de Kolwezi, quand les forces de l’ordre ont voulu interdire l’invasion des concessions de la Kamoto Copper Company, dont le principal actionnaire est le trader Glencore. Selon les témoins, il y a eu des blessés par balles dans les deux camps et des morts. Deux commissariats ont été incendiés.
À l’origine de cette situation : l’absence de programme alternatif pour l’emploi pour les creuseurs expulsés des concessions, en partie d’anciens mineurs licenciés durant la crise en 2009. En outre, le manque de soutien des pouvoirs publics à l’agriculture depuis plusieurs décennies ne favorise pas la réinsertion des creuseurs. Et l’industrie ne peut en absorber qu’une partie.
Pendant ce temps, l’interminable révision des contrats miniers, amorcée en 2007, a débouché sur des conflits juridiques qui pourraient inhiber les investisseurs occidentaux. Épisode le plus emblématique : la résiliation en août 2009 du permis de la firme canadienne First Quantum Minerals (FQM) sur les terrils de Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT), au moment même où la production aurait dû démarrer à hauteur 70 000 tonnes de cuivre par an. Cette affaire oppose aussi à Kinshasa les deux partenaires institutionnels de FQM, la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale, et la sud-africaine Industrial Development Corporation (IDC). Gênant.
Société cache-sexe
Depuis, le conflit a dégénéré. En janvier 2010, le gouvernement s’est empressé d’octroyer la concession à la société écran offshore Highwinds, inconnue au bataillon, cache-sexe du sulfureux diamantaire israélien Dan Gertler, à qui un rapport parlementaire congolais (voir AA 56) attribue la ruine de la compagnie diamantifère Minière de Bakwanga. En février, les choses ont empiré avec la saisie – annoncée, ô sacrilège, par FQM durant la grand-messe annuelle de l’industrie minière Indaba en Afrique du Sud –, de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris. Celle-ci, dans un arrêt daté du 19 août 2010, a interdit à la RDC de transférer le permis en cause, dans l’attente d’une décision définitive. Mais dès le lendemain, bravant l’arrêt de la CCI, un nouvel acteur annonçait avoir racheté la majorité des parts de la société Camrose de Gertler, véritable propriétaire de Highwinds, et l’Eurasian Natural Resources Corporation du milliardaire kazakh Patokh Chodiev.
Qui plus est, le gouvernement congolais a autorisé un autre transfert. Après le retrait en mai par la Cour suprême des permis de Frontier et de Comisa – également propriétés de FQM –, pourtant déjà en exploitation, on a appris début septembre qu’ils seraient exploités par une joint-venture créée par la société d’État Sodimico et le groupe China Fortune Holdings, de Hong-Kong. Mais le PDG de First Quantum, Philip Pascall, a menacé aussitôt de recourir à l’arbitrage d’une autre instance : le Centre international pour le règlement des différends sur l’investissement de Washington. De son côté, le ministre congolais des Mines, Martin Kabwelulu, a justifié la révocation des licences de FQM sous prétexte qu’elles étaient « illégales » et que ses dirigeants seraient impliqués dans des « malversations ». Quant à la Banque mondiale, elle a décidé de suspendre un projet d’appui au secteur minier congolais. Bref, c’est l’escalade. Et la montée des difficultés entre Kinshasa et les bailleurs de fonds occidentaux. Déjà, en juillet, le gouvernement d’Ottawa s’est opposé, lors du sommet du G20, à l’allègement de la dette congolaise dans le cadre de l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE.)
Indiscutablement, la gestion du patrimoine minier congolais ne se fait pas dans la sérénité. À Kinshasa, l’opposition dénonce le « bradage » d’une participation de l’État, détenue à travers l’Office des mines d’or de Kilo-Moto, correspondant à 20 % du capital de la compagnie Kibali Goldmines. Le député du Mouvement de libération du Congo, Fidèle Babala, reproche à la ministre du Portefeuille, Jeannine Mabunda, d’avoir donné son aval à la vente de ces parts aux compagnies AngloGold Ashanti et Randgold, pour seulement 113 millions de dollars. Alors que, selon lui, les réserves dépasseraient 28 millions d’onces, représentant une valeur de 30 milliards. L’État aurait donc subi un préjudice de plusieurs milliards de dollars, accuse Babala. « Faux », rétorque la ministre, qui souligne que seules les réserves certifiées (soit 5,5 millions d’onces) et non des réserves potentielles ont été prises en compte pour la transaction. Même si on applique ce critère, il y a au minimum un manque à gagner pour l’État de plusieurs centaines de millions de dollars, rétorquent ses détracteurs.





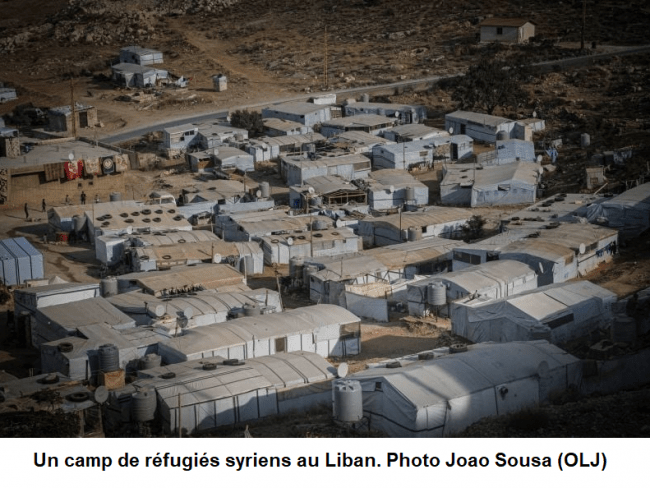
 Merci de patienter...
Merci de patienter...



